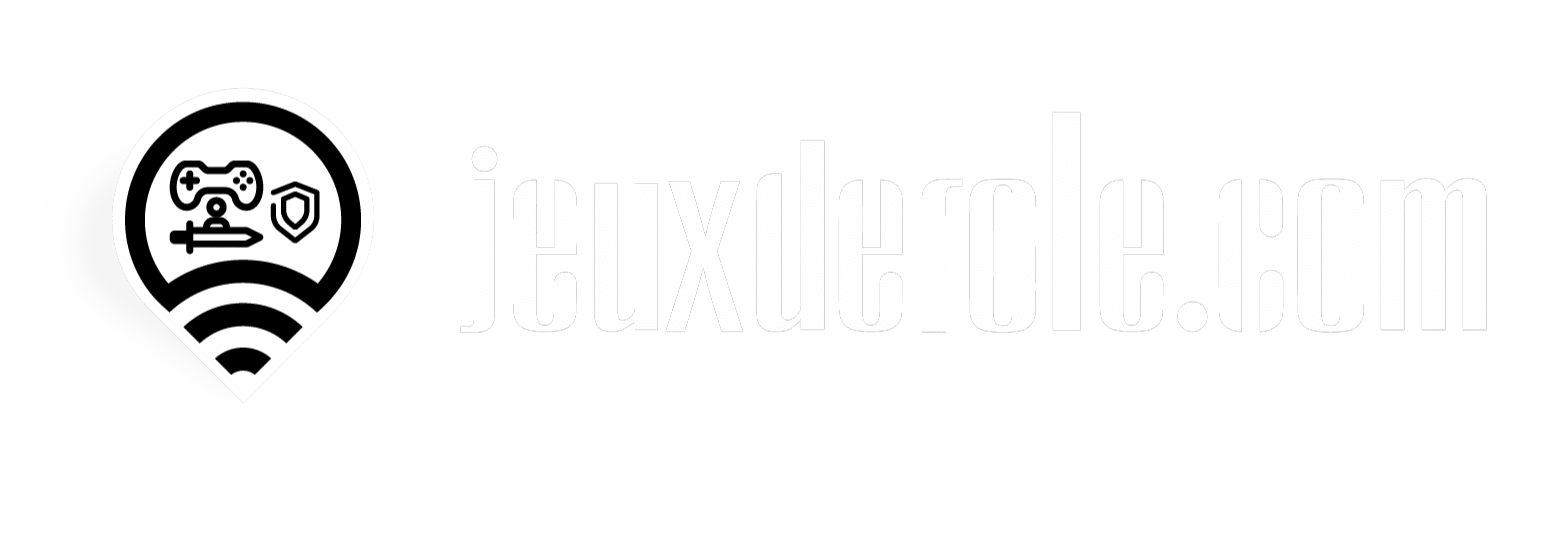Les Personnages Non-Joueurs ou Personnages Non Jouables (PNJ) est un élément incontournable des jeux ou presque. Il ne doit donc pas être négligé de sa création à son utilisation.
Bien que les personnages joueurs soient au centre des jeux de rôle, ils ont besoin d’autres éléments pour en faire bouger l’intrigue. C’est là que les PNJ entrent en jeu et ici, nous allons découvrir comment les rendre intéressants pour tout système.
Personnages Non-Joueurs : définition
Les Personnages Non-Joueurs sont complémentaires avec le Personnage Joueur (PJ). Ces premiers sont incarnés par le meneur, géré par l’intelligence artificielle ou programmé pour répéter une action.
À la différence des PJ qui sont des avatars des joueurs, ils ne sont pas tout à fait ceux du meneur. En effet, les Personnages Non-Joueurs n’ont pas à se demander « qui incarner ? », mais plutôt ce qu’il incarner ? C’est-à-dire qu’ils doivent avoir une nécessité dans le monde du jeu et dans son scénario.
Typologie des PNJ
Le figurant
Le rôle le plus simple des Personnages Joueurs consiste à meubler le jeu. Qu’il soit un adjuvant, opposant ou figurant, un PNJ est là pour que les joueurs soient immergés dans un monde bien vivant. Autrement dit, c’est la fermière du coin, c’est l’enfant qui joue, c’est le chat sur le toit… Il est là pour faire joli et généralement ne va pas plus loin. Oui, « généralement » parce que dans le cas des jeux de rôle papier, les joueurs ont une certaine liberté d’action qui peut pousser ce PNJ dans une autre catégorie.
Dites-vous bien que si vous décrivez qu’un chat est présent, il y a des chances que l’un des joueurs se décide à le caresser, le chouchouter… ou à l’emporter. Comment gérer cela ? Nous le verrons après.
Le personnage secondaire
La catégorie au-dessus du figurant est celle qui tient un rôle mineur dans le scénario. Cette fois-ci, le Personnage Non-Joueur est là pour une ou plusieurs scènes au cours pour interagir en bien, en mal ou ni l’un ni l’autre avec les joueurs pour faire avancer l’intrigue.
Celui-ci, c’est Martin le forgeron du village qui a besoin de matériel pour fabriquer une épée, c’est La Fouine, le voleur que les joueurs doivent arrêter ce soir. Ils n’ont pas à savoir grand-chose sur lui et si ça se trouve, c’est probablement la seule fois où ils interagiront avec.
Néanmoins, il peut être amené à évoluer. Un joueur peut trouver de l’intérêt pour La Fouine par exemple et choisir de s’en faire un rival sur le long terme, le Moriarty de son Sherlock.
Le personnage central
La dernière catégorie de Personnages Non-Joueurs correspond également à un élément central au scénario. Il n’est pas exagéré de dire que sans lui, il n’y aurait pas de phase de jeu, pas d’intrigue. Dans certains cas, ce personnage est l’objet de l’intrigue. Ces PNJ sont aussi développés que les PJ.
Pour illustrer, c’est par exemple Edwin Marlon. À 72 ans, ce mystérieux professeur d’archéologie à l’université d’Arkham, Massachusetts a engagé une équipe de spécialistes pour son expédition en Afrique, l’œuvre de toute sa vie. C’est cette initiative qui réunit les PJ qui n’auraient pas de raison de participer à cette aventure.
Comment gérer ses Personnages Non-Joueurs ?

Construire graduellement les Personnages Non-Joueurs
Ces descriptions vous ont peut-être donné une idée sur comment gérer les Personnages Non-Joueurs. Le Chat, La Fouine et le professeur Marlon en sont tous, mais ils se différencient par le souci du détail que le meneur leur apporte. Il est proportionnel à leur rôle. Vous aurez des dizaines, voire centaines de PNJ. Il faudra donc donner cette profondeur là où elle importe afin de ne pas être submergé.
Cette méthode permet aussi de guider discrètement les joueurs. Lâchez le nom d’un personnage au cours d’une conversation et au prochain tour de table et vous serez quasiment sûr qu’ils vont essayer de le rencontrer ou d’en apprendre plus sur lui.
Les JDR étant ce qu’ils sont cependant, les joueurs peuvent parfois pousser l’interaction avec les Personnages Non-Joueurs. Dans ce cas, prenez la typologie ci-dessus et faites-les monter progressivement dans l’importance. Un joueur veut emporter le chat ? Laissez-le faire et construisez-le progressivement : quelle couleur ? Quel tempérament ? Etc.
Être prêt, mais pas trop
Cette approche a aussi l’avantage de donner aux joueurs une certaine forme de contrôle sur l’histoire. En leur laissant cette liberté, vous n’en rendrez les parties que meilleures et mémorables : vous serez surpris de l’attachement que les joueurs peuvent développer pour ce chat.
Entre autres, il s’agit d’un exercice d’équilibriste que le meneur de jeu a à jouer. Ceci vient avec le territoire : le meneur doit être suffisamment préparé, mais resté flexible avec ses Personnages Non-Joueurs. Ainsi, si vos taquins de joueurs « se débarrassent » du professeur Marlon, inventez une autre raison de les envoyer sur la bonne voie.
Puisqu’on parle d’improvisation, avoir une liste de noms aléatoire et de quoi prendre note est aussi nécessaire. Vos joueurs vont probablement vous pousser à inventer des Personnages Non-Joueurs au vol, et sauf en dernier recours, inutile d’interrompre la partie pour ça.
Vous n’avez pas été MJ tant que vos joueurs n’ont pas questionné la marchande de choux qui passait par là pendant des heures. Cinq minutes après son introduction ce personnage de remplissage est devenu madame Anna, mariée, 2 enfants, habite dans le faubourg nord et les PJ vont y dîner ce soir ! Ce genre de surprise fait partie des charmes du JDR.
Les rouages derrière le Personnage non-joueur
Sur le plan mécanique, les différents systèmes de jeu gèrent tout aussi différemment les PNJ. Ce choix de design tient à la philosophie même du jeu et suit plutôt sa cohérence au lieu de la logique au sens propre.
Ainsi, dans les jeux les plus simulationnistes suivant la typologie LNS le personnage non-joueur peut suivre exactement les même règles qu’un PJ. Si cette approche est la plus complète et logique, elle est lourde. En effet, il en résulte que le moindre individu va avoir sa biographie, une liste de modificateurs, d’équipements… qui auront tendance à ralentir un jeu si sa mécanique est complexe. Traveller suit ce modèle.
À l’opposé, on trouve les jeux narratifs qui peuvent doter les PNJ de mécaniques très différentes des personnages joueurs. Ceux propulsés par l’Apocalypse ou par Freeform par exemple limitent les jets aux joueurs. En conséquence, les actions des autres acteurs sont reflétées par leurs résultats ou suivant les besoins de la narration. La fluidité de cette approche lui vaut toutefois de gagner en popularité, y compris chez les jeux OSR.
Ces derniers appartenaient plutôt à la dernière catégorie soit les jeux à tendance ludique coupent la poire en deux. À l’instar des premiers, ils confèrent aux PNJ des mécaniques proches des PJ, mais peuvent les simplifier ou les complexifier en fonction de l’importance de son importance. C’est le cas de DnD où les personnages notables comme la déesse Lolth possèdent des compétences et de l’équipement inédit.